|
| Sept
textes composent le G.T. :
1. Le portrait d'Arrias (La Bruyère) ;
2. Deux extraits de la s. 4 de l'Acte II du Misanthrope (Molière)
;
3. Extrait de l'Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre de
Bossuet ;
4. Extrait de L'Éducation sentimentale (Flaubert) ;
5. Monsieur Prudhomme de Verlaine ;
6. Un article du journal Libération (Portrait de Christine
Arron).
Texte 1
La Bruyère,  Les Caractères : Le portrait d'Arrias
Les Caractères : Le portrait d'Arrias
Arrias a tout lu, a tout vu, il veut
le persuader ainsi ; c’est un homme universel, et il se
donne pour tel ; il aime mieux mentir que de se taire ou de
paraître ignorer quelque chose. On parle à la table d’un grand
d’une cour du Nord ; il prend la parole, et l’ôte à
ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent ; il s’oriente
dans cette région lointaine comme s’il en était
originaire ; il discourt des mœurs de cette cour, des femmes
du pays, de ses lois et de ses coutumes ; il récite des
historiettes qui y sont arrivées il les trouve plaisantes, et il
en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu'un se hasarde de le
contredire, et lui prouve nettement qu’il dit des choses qui ne
sont pas vraies. Arrias ne se trouble point, prend feu au
contraire contre l’interrupteur ; " Je n’avance
rien, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’original :
je l’ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans cette cour,
revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais
familièrement, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché
aucune circonstance. " Il reprenait le fil de sa
narration avec plus de confiance qu’il ne l’avait commencée,
lorsque l’un des conviés lui dit : " C’est
Sethon à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive fraîchement
de son ambassade. "
La Bruyère, Des Caractères, V, " De la
société et de la conversation ".
Questionnaire :
A quel " type"
de texte appartient ce passage ?
Que pensez-vous de la façon dont se termine ce texte ?
Essayez de déterminer la valeur du présent.
Texte 2
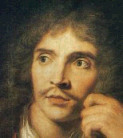 Molière, Le Misanthrope
Molière, Le Misanthrope
(1)
CLITANDRE.
Parbleu ! Je viens du Louvre, où
Cléonte, au levé,
Madame, a bien paru ridicule achevé.
N' a-t-il point quelque ami qui pût, sur ses manières,
D' un charitable avis lui prêter les lumières ?
CÉLIMÈNE.
Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort ;
Partout il porte un air qui saute aux yeux d' abord ;
Et lorsqu' on le revoit après un peu d' absence,
On le retrouve encor plus plein d' extravagance.
ACASTE.
Parbleu ! S' il faut parler de gens extravagants,
Je viens d' en essuyer un des plus fatigants :
Damon, le raisonneur, qui m' a, ne vous déplaise,
Une heure, au grand soleil, tenu hors de ma chaise.
CÉLIMÈNE.
C' est un parleur étrange, et qui trouve toujours
L' art de ne vous rien dire avec de grands discours ;
Dans les propos qu' il tient, on ne voit jamais goutte,
Et ce n' est que du bruit que tout ce qu' on écoute.
ELIANTE, à PHILINTE.
Ce début n' est pas mal ; et contre le prochain
La conversation prend un assez bon train.
CLITANDRE.
Timante encor, madame, est un bon caractère.
CÉLIMÈNE.
C' est de la tête aux pieds un homme tout mystère,
Qui vous jette en passant un coup d' œil égaré,
Et, sans aucune affaire, est toujours affairé.
Tout ce qu' il vous débite en grimaces abonde ;
À force de façons, il assomme le monde ;
Sans cesse il a, tout bas, pour rompre l' entretien,
Un secret à vous dire, et ce secret n' est rien ;
De la moindre vétille il fait une merveille,
Et jusques au bonjour, il dit tout à l' oreille.
ACASTE.
Et Géralde, madame ?
CÉLIMÈNE.
Ô l' ennuyeux conteur !
Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur ;
Dans le brillant commerce il se mêle sans cesse,
Et ne cite jamais que duc, prince ou princesse :
La qualité l'entête ; et tous ses entretiens
Ne sont que de chevaux, d' équipage et de chiens ;
Il tutaye en parlant ceux du plus haut étage,
Et le nom de monsieur est chez lui hors d' usage.
CLITANDRE.
On dit qu' avec Bélise il est du dernier bien.
CÉLIMÈNE.
Le pauvre esprit de femme, et le sec entretien !
Lorsqu' elle vient me voir, je souffre le martyre :
Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire,
Et la stérilité se son expression
Fait mourir à tous coups la conversation.
En vain, pour attaquer son stupide silence,
De tous les lieux communs vous prenez l' assistance :
Le beau temps et la pluie, et le froid et le chaud
Sont des fonds qu' avec elle on épuise bientôt.
Cependant sa visite, assez insupportable,
Traîne en une longueur encore épouvantable ;
Et l' on demande l' heure, et l' on bâille vingt fois,
Qu' elle grouille aussi peu qu' une pièce de bois.
ACASTE.
Que vous semble d'Adraste ?
CÉLIMÈNE.
Ah ! Quel orgueil extrême !
C' est un homme gonflé de l' amour de soi-même.
Son mérite jamais n' est content de la cour :
Contre elle il fait métier de pester chaque jour,
Et l' on ne donne emploi, charge ni bénéfice,
Qu' à tout ce qu' il se croit on ne fasse injustice.
CLITANDRE.
Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hui
Nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui ?
CÉLIMÈNE.
Que de son cuisinier il s' est fait un mérite,
Et que c' est à sa table à qui l' on rend visite.
ELIANTE.
Il prend soin d' y servir des mets fort délicats.
CÉLIMÈNE.
Oui ; mais je voudrois bien qu' il ne s' y servît pas :
C' est un fort méchant plat que sa sotte personne,
Et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu' il donne.
PHILINTE.
On fait assez de cas de son oncle Damis :
Qu' en dites-vous, madame ?
CÉLIMÈNE.
Il est de mes amis.
PHILINTE.
Je le trouve honnête homme, et d' un air assez sage.
CÉLIMÈNE.
Oui ; mais il veut avoir trop d' esprit, dont j'enrage ;
Il est guindé sans cesse ; et dans tous ses propos,
On voit qu' il se travaille à dire de bons mots.
Depuis que dans la tête il s' est mis d' être habile,
Rien ne touche son goût, tant il est difficile ;
Il veut voir des défauts à tout ce qu' on écrit,
Et pense que louer n' est pas d' un bel esprit,
Que c' est être savant que trouver à redire,
Qu' il n' appartient qu' aux sots d' admirer et de rire,
Et qu' en n' approuvant rien des ouvrages du temps,
Il se met au-dessus de tous les autres gens ;
Aux conversations même il trouve à reprendre :
Ce sont propos trop bas pour y daigner descendre ;
Et les deux bras croisés, du haut de son esprit
Il regarde en pitié tout ce que chacun dit.
ACASTE.
Dieu me damne, voilà son portrait véritable.
CLITANDRE.
Pour bien peindre les gens vous êtes admirable.
Le Misanthrope, Acte II, scène IV .
Questionnaire :
En vous aidant d’une édition du Misanthrope,
écrivez pour cet extrait un " chapeau " qui
situera le passage et précisera les éléments utiles à sa
compréhension.
Nommez le ridicule de chacun des personnages dont
Célimène fait le portrait.
Texte 3
Molière, Le Misanthrope
(2)
ELIANTE.
L' amour, pour l' ordinaire, est peu fait à ces lois,
Et l' on voit les amants vanter toujours leur choix ;
Jamais leur passion n' y voit rien de blâmable,
Et dans l'objet aimé tout leur devient aimable :
Ils comptent les défauts pour des perfections,
Et savent y donner de favorables noms.
La pâle est aux jasmins en blancheur comparable ;
La noire à faire peur, une brune adorable ;
La maigre a de la taille et de la liberté ;
La grasse est dans son port pleine de majesté ;
La malpropre sur soi, de peu d' attraits chargée,
Est mise sous le nom de beauté négligée ;
La géante paroît une déesse aux yeux ;
La naine, un abrégé des merveilles des cieux ;
L' orgueilleuse a le cœur digne d' une couronne ;
La fourbe a de l' esprit ; la sotte est toute bonne ;
La trop grande parleuse est d' agréable humeur ;
Et la muette garde une honnête pudeur.
C' est ainsi qu' un amant dont l' ardeur est extrême
Aime jusqu' aux défauts des personnes qu' il aime.
Le Misanthrope, Acte II, scène IV .
Questionnaire :
Rajoutez quelques vers à ceux d’Éliante (après le
v. 728) en en conservant le principe (par exemple : la
boiteuse, la distraite, la coquette, la snob, l’aguicheuse…).
Exemple :
La marche de la boiteuse est une vraie danse.
La snob a le souci de la grande élégance.
La coquette n'a qu'un désir, celui de plaire,
Quant à la bègue, elle respecte la grammaire.
(Bon moyen de faire acquérir
ou revoir les bases de la versification.)
Texte 4
Oraison
funèbre de Henriette-Anne d’Angleterre, duchesse d’Orléans
:
prononcée à Saint-Denis le 21
jour d’aoust, 1670 par Messire Jacques-Bénigne Bossuet.
[…] Et certainement, messieurs, si quelque chose pouvait élever
les hommes au-dessus de leur infirmité naturelle ; si l’origine,
qui nous est commune, souffrait quelque distinction solide et
durable entre ceux que Dieu a formés de la même terre, qu’y
aurait-il dans l’univers de plus distingué que la princesse
dont je parle ? Tout ce que peuvent faire non seulement la
naissance et la fortune, mais encore les grandes qualités de l’esprit,
pour l’élévation d’une princesse, se trouve rassemblé, et
puis anéanti dans la nôtre. De quelque côté que je suive les
traces de sa glorieuse origine, je ne découvre que des rois, et
partout je suis ébloui de l’éclat des plus augustes couronnes.
Je vois la maison de France, la plus grande, sans comparaison, de
tout l’univers, et à qui les plus puissantes maisons peuvent
bien céder sans envie, puisqu’elles tâchent de tirer leur
gloire de cette source. Je vois les rois d’Ecosse, les rois d’Angleterre,
qui ont régné depuis tant de siècles sur une des plus
belliqueuses nations de l’univers plus encore par leur courage
que par l’autorité de leur sceptre. Mais cette princesse, née
sur le trône, avait l’esprit et le cœur plus hauts que sa
naissance. […] Souvenez-vous donc, messieurs, de l’admiration
que la princesse d’Angleterre donnait à toute la cour. Votre
mémoire vous la peindra mieux, avec tous ses traits et son
incomparable douceur, que ne pourront jamais faire toutes mes
paroles. Elle croissait au milieu des bénédictions de tous les
peuples, et les années ne cessaient de lui apporter de nouvelles
grâces. […] Que si son rang la distinguait, j’ai eu raison de
vous dire qu’elle était encore plus distinguée par son
mérite. Je pourrais vous faire remarquer qu’elle connaissait si
bien la beauté des ouvrages de l’esprit, que l’on croyait
avoir atteint la perfection quand on avait su plaire à madame. Je
pourrais encore ajouter que les plus sages et les plus
expérimentés admiraient cet esprit vif et perçant, qui
embrassait sans peine les plus grandes affaires, et pénétrait
avec tant de facilité dans les plus secrets intérêts. Mais
pourquoi m’étendre sur une matière où je puis tout dire en un
mot ? Le roi, dont le jugement est une règle toujours sûre, a
estimé la capacité de cette princesse, et l’a mise par son
estime au-dessus de tous nos éloges. Cependant ni cette estime,
ni tous ces grands avantages n’ont pu donner atteinte à sa
modestie. Toute éclairée qu’elle était, elle n’a point
présumé de ses connaissances, et jamais ses lumières ne l’ont
éblouie. Rendez témoignage à ce que je dis, vous que cette
grande princesse a honorés de sa confiance. Quel esprit avez-vous
trouvé plus élevé ? Mais quel esprit avez-vous trouvé plus
docile ? Plusieurs, dans la crainte d’être trop faciles, se
rendent inflexibles à la raison, et s’affermissent contre elle.
Madame s’éloignait toujours autant de la présomption que de la
faiblesse ; également estimable, et de ce qu’elle savait
trouver les sages conseils, et de ce qu’elle était capable de
les recevoir. On les sait bien connaître, quand on fait
sérieusement l’étude qui plaisait tant à cette princesse.
Nouveau genre d’étude, et presque inconnu aux personnes de son
âge et de son rang ; ajoutons, si vous voulez, de son sexe. Elle
étudiait ses défauts ; elle aimait qu’on lui en fît des
leçons sincères : marque assurée d’une âme forte, que ses
fautes ne dominent pas, et qui ne craint point de les envisager de
près, par une secrète confiance des ressources qu’elle sent
pour les surmonter. C’était le dessein d’avancer dans cette
étude de sagesse, qui la tenait si attachée à la lecture de l’histoire,
qu’on appelle avec raison la sage conseillère des princes. C’est
là que les plus grands rois n’ont plus de rang que par leurs
vertus, et que, dégradés à jamais par les mains de la mort, ils
viennent subir, sans cour et sans suite, le jugement de tous les
peuples et de tous les siècles. C’est là qu’on découvre que
le lustre qui vient de la flatterie est superficiel, et que les
fausses couleurs, quelque industrieusement qu’on les applique,
ne tiennent pas. Là, notre admirable princesse étudiait les
devoirs de ceux dont la vie compose l’histoire : elle y perdait
insensiblement le goût des romans et de leurs fades héros ; et,
soigneuse de se former sur le vrai, elle méprisait ces froides et
dangereuses fictions. Ainsi, sous un visage riant, sous cet air de
jeunesse qui semblait ne promettre que des jeux, elle cachait un
sens et un sérieux dont ceux qui traitaient avec elle étaient
surpris. Aussi pouvait-on sans crainte lui confier les plus grands
secrets. Loin du commerce des affaires et de la société des
hommes, ces âmes sans force, aussi bien que sans foi, qui ne
savent pas retenir leur langue indiscrète ! Ils ressemblent, dit
le sage, à une ville sans murailles, qui est ouverte de toutes
parts, et qui devient la proie du premier venu. Que madame était
au-dessus de cette faiblesse ! Ni la surprise, ni l’intérêt,
ni la vanité, ni l’appât d’une flatterie délicate, ou d’une
douce conversation, qui souvent, épanchant le cœur, en fait
échapper le secret, n’était capable de lui faire découvrir le
sien ; et la sûreté qu’on trouvait en cette princesse, que son
esprit rendait si propre aux grandes affaires, lui faisait confier
les plus importantes. […]
Questionnaire :
Lisez ce texte plusieurs fois à
haute voix. Quelles remarques pouvez-vous faire après ces
lectures ?
A l’aide d’un manuel ou d’un support numérique
(" Dictionnaire des Œuvres de la Littérature
Française ", par exemple), vous direz à quel genre de
littérature appartiennent les œuvres de Bossuet, dont vous
recenserez les principales . Quelles remarques cela vous
inspire-t-il ?
Définissez la situation d’énonciation.
Quelles sont les formes grammaticales et rhétoriques de l’éloge ?
(Ces questions sont apparues trop difficiles pour
mes élèves et pas assez judicieuses. Il fallait faire
noter les formes de l'éloge à travers l'emploi des superlatifs :
les occurrences de "plus" sont considérables ; les
termes mélioratifs, nombreux. A partir de là, il était facile
de faire observer que ce portrait moral est très idéalisé et
presque abstrait.)
Texte 5
Gustave Flaubert, L’Éducation
sentimentale :
" Ce fut comme une apparition "
Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du
moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui
envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, elle leva la
tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et,
quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui
palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs,
contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très
bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de sa figure. Sa
robe de mousseline claire, tachetées de petits pois, se
répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder
quelque chose ; et son nez droit, son menton, toute sa
personne se découpait sur le fond de l’air bleu.
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de
droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre ; puis il se
planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il
affectait d’observer une chaloupe sur la rivière.
Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la
séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la
lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec
ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son
nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait
connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu’elle
avait portées, les gens qu’elles fréquentait ; et le
désir de la possession physique même disparaissait sous une
envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n’avait
pas de limites.
Une négresse, coiffée d’un foulard, se présenta, en tenant
par la main une petite fille, déjà grande. L’enfant, dont les
yeux roulaient des larmes, venait de s’éveiller. Elle la prit
sur ses genoux. " Mademoiselle n’était pas sage,
quoiqu’elle eût sept ans bientôt ; sa mère ne l’aimerait
plus ; on lui pardonnait trop ses caprices. " Et
Frédéric se réjouissait d’entendre ces choses, comme s’il
eût fait une découverte, une acquisition.
Il la supposait d’origine andalouse, créole peut-être ;
elle avait ramené des îles cette négresse avec elle ?
Cependant, un long châle à bandes violettes était placé
derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien
des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en
envelopper sa taille, s’en couvrir les pieds, dormir
dedans ! Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à
peu, il allait tomber dans l’eau ; Frédéric fit un bond
et le rattrapa. Elle lui dit :
– Je vous remercie, monsieur.
Leurs yeux se rencontrèrent.
– Ma femme, es-tu prête ? cria le sieur Arnoux,
apparaissant dans le capot de l’escalier.
Gustave Flaubert,
L’Éducation sentimentale, I, 1.
Remarques pour un
questionnaire :
De qui et de quoi s'agit-il ? D'une rencontre amoureuse, d'un coup
de foudre à sens unique. (Mais est-ce bien sûr ? Mme Arnoux
est-elle complètement insensible au jeune homme qui l'observe ?)
Repérage des passages narratifs et descriptifs. Conclusion
provisoire : description "impure", orientée, subjective
(explication au passage du couple de termes objectif / subjectif).
Le discours direct et indirect libre, le monologue intérieur
voisinent avec les narrations et les descriptions. L'écriture
"artiste" de Flaubert amené à employer le substantif,
là où l'on attend un adjectif épithète ("cette splendeur
de sa peau brune",...). Portrait incomplet et idéalisé.
Texte 6
"Monsieur Prud'homme"
Il est grave : il est maire et
père de famille.
Son faux col engloutit son oreille. Ses yeux
Dans un rêve sans fin flottent insoucieux,
Et le printemps en fleur sur ses pantoufles brille.
Que lui fait l'astre d'or, que lui
fait la charmille
Où l'oiseau chante à l'ombre, et que lui font les cieux,
Et les prés verts et les gazons silencieux ?
Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille
Avec monsieur Machin, un jeune
homme cossu.
Il est juste-milieu, botaniste et pansu.
Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles,
Ces fainéants barbus, mal
peignés, il les a
Plus en horreur que son éternel coryza,
Et le printemps en fleur brille sur ses pantoufles.
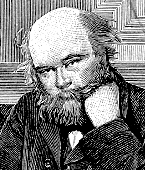 Paul Verlaine (1844 -
1896), Poèmes Saturniens, 1863.
Paul Verlaine (1844 -
1896), Poèmes Saturniens, 1863.
Questionnaire :
Apprendre par cœur le poème et se tenir prêt à
répondre oralement au moment de l'interrogation à des questions
de compréhension sur le texte.
(Vif succès de cette formule,
séance prolongée à la demande des élèves)
Texte 7
Christine Arron, 25 ans. Sprinteuse nonchalante, Elle
prépare les championnats du monde de Séville sans angoisse.
Bulle en tête
Christine
Arron en 5 dates
13 septembre 1973
Naissance aux Abymes, en Guadeloupe.
1992
Débarque en métropole.
1996
Blessée. Doit renoncer aux JO d'Atlanta.
1997
Quatrième du 100 mètres des championnats du monde
d'Athènes.
1998
Titre et record d'Europe du 100 mètres à Budapest. |
|
 |
Par LUC LE VAILLANT PHOTO ERIC
FRANCESCHI
LIBÉRATION
DU 20/07/1999
Je suis égoïste. Je me
vois moi, dans mon sport. Je ne m'intéresse pas trop aux
autres... Je commence à m'ouvrir un peu. Je ne suis pas bornée.
Je ne suis pas asociale."
Elle aime la lenteur, refuse
qu'on la presse, veut pouvoir traîner à table sans qu'on lui
tire la nappe sous les coudes et ralentit parfois dans les
couloirs de correspondances quand Elle se surprend à stresser
comme un métropolitain. Sinon, Christine Arron est une sprinteuse.
Son talent, c'est la vitesse. Son métier, c'est de grignoter des
dixièmes de seconde. Elle court le 100 mètres, le 200 mètres.
Elle est guadeloupéenne comme Marie-José Pérec, à laquelle
Elle pourrait bien succéder au faîte de l'athlétisme français.
Elle se prépare pour le Mondial de Séville cet été, pour les
JO de Sydney l'an prochain. Elle va devoir accélérer encore si
Elle veut remettre le grappin sur Marion Jones, sa grande rivale
américaine, qui rappelle Carl Lewis par son potentiel. Elle ne se
bile pas pour autant. Courir comme une dératée ne vaut pas qu'on
s'inflige des aigreurs d'estomac. ça viendra, ça viendra pas, on
verra bien.
Enfance aux îles à sucre. Vingt premières années en
Guadeloupe. Famille assez aisée, plutôt aimante, très
rassurante, à l'inverse de celle de Pérec, plus déstructurée.
Le père est professeur de maths-physique. La mère est
infirmière en pédiatrie. Les grands-parents gravitent entre
fonction publique et petites entreprises. Elle est la petite
dernière. Aurait aimé une sœur, a deux frères, l'un est
aujourd'hui mécanicien d'avion, l'autre fait dans l'agriculture
biologique. Vie au grand air, jeux avec les cousins, plaisirs de
garçon manqué, bonheur de les battre à la course. Les études
vont doucettement. L'athlétisme la prend par hasard. Elle y
réussit sans y toucher, sans forcer. Dans sa chambre
d'adolescente, aucun symptôme d'adulation: ni posters de héros
sportifs, ni effigies de stars de la chanson ou du ciné. Juste
deux images: un homme nu avec un bébé dans les bras, un visage
de femme en larmes.
Arron se dit "guadeloupéenne" avec mélancolie
et pragmatisme. Elle veut retourner y vivre, mais se méfie des
revendications indépendantistes. "Quand on voit les
difficultés, la pauvreté des îles alentour, de Haïti, de Cuba,
c'est pas joli-joli. ça donne pas envie." Elle
revendique son accent, fait honte à ceux qui s'en moquent,
apprécie que ça revienne quand Elle passe du temps au
téléphone avec sa mère. Elle ne traque pas le racisme dans la
moindre acrimonie. Elle se souvient des difficultés à trouver un
logement en banlieue, remarque que la délinquance se colore vite,
sait que "quand on gagne, on est française, quand on
perd, on est antillaise", mais n'en fait pas un cheval de
bataille. Elle dit: "Je vis dans ma petite bulle." Elle
n'a jamais voté. Pense que son père est "plutôt à
gauche", sa grand-mère "plutôt à droite".
Se souvient qu'"on ne parlait pas de ça à la
maison". Apparaît parfois aux côtés de Jean Tiberi,
mais c'est pour cause de contrat avec la Ville de Paris. Elle se
promet de s'intéresser à la chose publique. ça viendra en son
temps. Rien ne presse. Il fait bon dans le cocon de la
compétition de haut niveau.
De la nonchalance, de l'indolence, mais pas de lymphatisme. Et
puis rien d'une bonne pomme... Une morgue pimentée, une violence
nécessaire, une mémoire rancunière. Un observateur: "Si
on la bouscule, si on lui manque de respect, Elle peut vous
battre froid pendant un bon moment." Elle connut une
ascension à l'eau de rose et puis des blessures assez rosses. On
compte ses amis, on se retranche sur la famille et on réalise que
l'on n'a pas le droit de gaspiller son talent, qu'il faut
commencer à travailler, accepter de souffrir pour retrouver ces
sensations incroyables du corps glorieux, de la foulée
sidérante, de l'accélération astronomique. En fait, Arron n'a
découvert l'athlétisme, ses exigences, que quand Elle est
entrée dans le groupe d'entraînement de Jacques Piasenta, qui
fut le tourmenteur perfectionniste de Pérec, avant que celle-ci
émigre à Los Angeles.
Entre Pérec et Arron, malgré la Guadeloupe, leur île natale,
malgré Reebok, leur équipementier commun, il y a plus de
différences que de similitudes. Pérec est une femme rétive et
malaisée, en ruptures et en réactivité, quand Arron préfère
les lignes droites, la belle vie, les fidélités à soi et aux
siens. L'une, Arron, semble douée pour le bonheur, quand l'autre,
Pérec, paraît incapable de faire la paix avec elle-même. Arron
aime s'installer, quand Pérec ne peut que tout plaquer. Arron
rayonne, sourit, s'épanouit, quand Pérec souffre, bredouille,
agresse. Pourtant, l'une (Pérec) a sûrement plus de talent
naturel que l'autre (Arron). Évidemment, l'une et l'autre
s'ignorent. Ce ne sont pas des querelles de basse-cour, ce sont
des procédures de sauvegarde. L'orgueil est la colonne
vertébrale du champion. Il faut croire en soi, se retrancher dans
son ego, ne pas croiser le regard de l'autre, de peur de toiser de
trop haut ou de baisser les cils trop vite. Arron a le chic pour
se cloîtrer dans son monde. Elle admet: "Je suis
égoïste. Je me vois moi, dans mon sport. Je ne m'intéresse pas
trop aux autres." Elle nuance: "Je commence à
m'ouvrir un peu. Je ne suis pas bornée. Je ne suis pas
asociale." Mais, Elle qui abandonna ses études de prof
de gym pour un BTS de communication qu'Elle suit à la paresseuse,
admet: "Je ne me vois pas entraîneur. Je ne pourrais pas
donner aux gens autant de temps, d'attention, comme le fait
Piasenta. Je n'aurais pas la patience."
Arron n'aime pas se forcer. Pour la lecture, comme pour le
reste. Elle qui parle créole a tenté de s'immerger dans Texaco,
le livre de Patrick Chamoiseau. ça n'a pas pris. Elle n'a pas
insisté. Pas question de se faire violence. Sinon, Elle peut
passer des heures au cinéma. Son rêve: s'offrir une salle de
projection privée. Elle préfère les comiques gaillards aux
minets déjantés, les sex-symbols seniors aux éphèbes
tourmentés, et côté femmes penche pour les bonnes copines
plutôt que pour les gourgandines.
Le corps d'Arron a tapé dans l'œil des magazines féminins. Elle
n'a pas les cuisses hypertrophiées de Florence Griffith-Joyner,
ni le côté gracile et perdu de Pérec. Malgré les polémiques
inévitables désormais quand se révèle un talent neuf, Elle ne
respire ni les anabolisants ni l'hormone de croissance. Elle est
bien balancée, équilibrée, avenante. Elle en pince pour les
mannequins avec formes comme Cindy Crawford, plutôt que pour les
brindilles anorexiques. Elle s'est longtemps amusée à se teindre
en blond, en rouge, en bleu. Elle a même réussi à peroxyder
Piasenta, suite à une victoire-pari. Ce matin-là, dans un hall
d'hôtel de la banlieue est où Elle vit, la coiffure est plus
classique. Jeans et blouson. Mais ongles carmin, brillant à la
narine, bijoux. Pas de minauderies, mais une assurance pas
ramenarde. Arron se déclare "pour l'égalité des
sexes", trouve qu'il serait temps de faire un enfant
"pour faire comme les copines", mais laisserait bien
son homme (un coureur de 110 haies) au foyer.
Tout semble aller bien. Des performances, un physique, un
entourage et des revenus de 100000 francs mensuels environ. D'où
la surprise de l'entendre se dire "terriblement
angoissée". Elle n'arrête pas de songer à la possible
disparition de ses proches. D'où le détour opiacé par le
religieux. "Dans le doute, mieux vaut imaginer qu'il y a
quelque chose après." Quitte à se hâter lentement d'y
aller voir.
Tableau
de synthèse
|
|
Admiration ou éloge |
Mépris ou blâme |
| |
Traits physiques |
Traits moraux |
Traits physiques |
Traits moraux |
| La
Bruyère : Arrias, (Les Caractères) |
|
|
|
|
| Molière :
Le Misanthrope (1) |
|
|
|
|
| Molière :
Le Misanthrope (2) |
|
|
|
|
| Bossuet :
Oraison funèbre |
|
|
|
|
| Flaubert :
L’Education sentimentale |
|
|
|
|
| Verlaine :
Monsieur Prudhomme |
|
|
|
|
| Journal
Libération : Portrait de Christine Arron |
|
|
|
|
Ecriture d’invention :
Vous interviewerez
une personne de votre choix à qui vous soumettrez le
" questionnaire de Proust ". A partir des
renseignements obtenus vous en composerez, un peu à la manière d’un
écrivain, le portrait.
Dans votre entreprise de rédaction vous vous efforcerez de
dissimuler que le matériau de base de votre écrit est constitué
de réponses à des questions.
Questionnaire de Marcel Proust
Quel est pour vous le comble de la
misère ?
Où aimeriez-vous vivre ?
Votre idéal de bonheur terrestre ?
Pour quelles fautes avez-vous le plus d'indulgence ?
Quels sont les héros de roman que vous préférez ?
Quel est votre personnage historique préféré ?
Vos héroïnes favorites dans la vie réelle ?
Vos héroïnes dans la fiction ?
Votre peintre favori ?
Votre qualité préférée chez l'homme ?
Votre qualité préférée chez la femme ?
Votre vertu préférée ?
Votre occupation préférée ?
Qui auriez-vous aimé être ?
Le principal trait de votre caractère ?
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?
Votre principal défaut ?
Votre rêve de bonheur ?
Quel serait votre plus grand malheur ?
Ce que je voudrais être ?
La couleur que je préfère ?
La fleur que j'aime ?
L'oiseau que je préfère ?
Mes auteurs favoris en prose ?
Mes poètes favoris ?
Mes héros dans la vie réelle ?
Mes héroïnes dans l'histoire ?
Mes noms favoris ?
Ce que je déteste par-dessus tout ?
Caractères historiques que je méprise le plus ?
Le fait militaire que j'admire le plus ?
La réforme que j'admire le plus ?
Le don de la nature que je voudrais avoir ?
Comment j'aimerais mourir ?
Etat présent de mon esprit ?
Ma devise ?
(Vous pouvez ignorer certaines questions, celles-ci par
exemple : 5, 6, 9, 23, 24, 25, 27,30, 31, 32) |
|
|